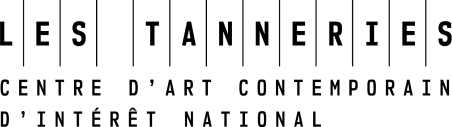Saison #8BIS – Nos maisons apparentées
DU 19 OCTOBRE 2024 AU 19 OCTOBRE 2025Visuel officiel de la saison #8BIS Nos maisons apparentées
Photo : Les Tanneries – CACIN, Amilly
Le lancement de la 9ᵉ saison artistique des Tanneries s’inscrit dans un nouveau cycle de programmation intitulé Nos maisons apparentées qui se déploie depuis octobre 2023 (saison #8) pour s’étirer jusqu’en octobre 2026 (terme de la saison #8Ter, 10ᵉ saison du centre d’art contemporain).
Sur ces 3 saisons artistiques, ces « maisons apparentées » sont, seront, auront été celles des artistes invité·e·s, des maisons imprégnées des réalités programmatiques attendues, en termes de diversité de formes artistiques et d’univers plastiques, de place donnée à la recherche, à l’expérimentation et aux nouvelles formes prises par la création la plus actuelle.
Jouant des suggestions apportées par le titre, dans le prolongement de ce qui fonde désormais l’identité artistique du centre d’art contemporain, ce cycle curatorial pluriannuel sera l’occasion d’investir les lieux et temps croisés de création et de pensée, les espaces marqués de gestes produits et de formes exprimées (dans l’atelier, dans la galerie d’exposition) qui sont les conditions de rencontre avec l’œuvre créée, le processus créatif.
Si tout ici est appréhendé comme autant de formes possibles d’habitations effectives qui sont celles déployées par les artistes en chacun des espaces des Tanneries, elles se complètent de celles « en devenir » nées des apparentements par lesquels seront mis en regard des éléments les uns aux autres, dans des formes d’intelligible où se déterminent les rapports à l’œuvre, pour l’artiste et le regardeur de l’art.
Ces maisons apparentées permettent en cela de resituer le lieu d’une expérience artistique partagée dans le temps d’un contemporain qui les lie doublement l’un à l’autre. Un lieu accessible au 8, au 8bis et au 8ter.
Depuis 2016 ce lieu est traversé du souffle d’une vie artistique qui ne cesse de révéler les figures qui l’activent, la déterminent, la « mobilisent ». En venant aux Tanneries, il est donc question de venir sur le « motif », là même où tout s’anime dans un frottement d’air.
Au seuil de la saison #8, dans les pas de Marco Godinho – et tel qu’avait su nous le narrer Thierry Davila quelques temps plus tard – l’inframince se faisait brin d’hospitalité.
Persistant dans le filet d’un souffle accompli, il gravite désormais sous la Verrière, dans les sinuosités creuses et translucides de Thickness of the air des mountaincutters, pour se prolonger, d’objets [horizons] en objets [incomplets], au long d’heures teintées (Petite Galerie). Les formes et les matières sont dans un état d’apparentement, fragile, ténu, subtil. Ce monde rassemblé est traversé d’une respiration essentielle. Elle s’échappe et se glisse un peu plus loin, se faisant brin d’air. Il se dit que les herbes folles et autres brindilles emportées par lui, sont autant de causes du désespoir des peintres. Pourtant, c’est bien un souffle de vie qui est la cause de toutes les concordes peintes chez Bruno Rousselot. De tous ses Tableaux manquants (Galerie Haute). C’est lui qu’il le motive à générer ces apparentements travaillés, d’une toile à l’autre, d’une série à l’autre, dans le continuum d’un geste, dans des déplacements feutrés et autrement subtils. L’espace pictural se fait paysage, contrée étendue de champs colorés, qu’il a s’agit d’abord pour l’artiste de laisser parcourir par ce souffle premier, intérieur, qui le poussait vers un champ des possibles. Ce qu’en atteste la décision de franchir l’océan et d’aller du côté de Brooklyn, de SoHo, pour jeter des passerelles utiles à son cheminement, pour aller mettre à l’épreuve ce souffle ressenti et depuis ne cesser d’en vérifier la vivacité reconduite. Si manque il y a, c’est d’abord une nécessité : celle d’un twist – une sorte d’enjambement, tout autant une autre forme de l’inframince – où bruite le swing d’une improvisation, la promesse d’un autre apparentement proposé. Alors luit dans l’œil du peintre et du regardeur, un humour décalé quant à ce subtil déséquilibre des formes qui relativise toute tentation à clore les espaces et à terminer l’histoire de la peinture. Cette cinématique est opérante et, dans le débordement d’une stricte géométrie, objectivée sur la notion d’espace, elle introduit la présence d’un temps non pas rejoué mais par essence, remis en jeu. C’est le récit d’une peinture perçue comme système (1).
De fil de récit en fil de récit, l’automne s’achevant, le temps est venu d’une narration faite de « nappes phrastiques », où, dans le courant des ondes qui creusent ou enflent la surface des choses, des crêtes de visibilité – pour un temps donné – semblent émerger.
Comme il est bon d’y reprendre son souffle, pour mieux replonger dans l’épaisseur des strates d’un récit pluriel, d’une pluie d’histoires ruisselantes au long d’un écran quasi sans fin (The Unmanned – Raphaël Siboni et Fabien Giraud – Grande Halle). Sur la toile éclairée par les projections synchrones, un corps cinématographique composé dans l’apparentement de scripts, de cadrages, de mouvements de caméras, d’affaires de morales et de montages, de séquences et de pistes sons, se découvre dans le parcours de son étendue, dans les méandres des réseaux câblés et l’immatérialité tentaculaire des techniques computationnelles ou du programme numérique qui lui donnent vie.
La multiplicité des figures et des corps s’activant – ceux projetés, ceux s’y projetant – redouble la dimension protéiforme d’un réordonnancement propice à inverser les pôles, pour lire à rebours et entrer dans un temps rétroversé. Dans cette course inversée, se profile les conditions d’un inhabité (unnamed), d’une expérience de navigation sans équipage (unmanned). À l’image d’un oculaire astronomique rendant l’image d’un astre observable par l’œil, au prix d’un état obsolète de sa réalité dans la temporalité même de son observation, entre dissolution et disparition, entre confusion et épiphanie, l’inframince se fait artéfact.
Au long de l’hiver, l’apparentement de ces mondes dans la Grande Halle tuile celui généré au fil des Voyages en Kaléidoscope de Erik Bullot (Galerie Haute). Une autre forme de programme poétique s’en dégage, constitutive d’un corps mental – lui aussi cinématographique – se révélant à travers des formes-pensées, des vibrations colorées suspendues – éléments constitutifs de l’intérieur d’une Glashaus [maison de verre] extrapolée – de fragments de film imaginaire, de tirages argentiques, de film-papier. Tout scintille dans la présence d’une lumière traversant le Rêve d’Abel Gance, film composé au banc-titre, dans un dialogue fécond entre l’artiste et une intelligence artificielle. Cette fiction poétique déjoue elle aussi les temporalités admises, délie les liens du récit, le filage de ses mises en œuvre, entre archéologie, autobiographie et émergence de données algorithmiques s’exécutant dans un environnement dynamique. Au croisement de ces récits apparentés, le cinétisme du langage dévoile la force de l’esprit humain à savoir concevoir des images plus ou moins achevées, se faisant l’enveloppe transitoire d’une réalité entraperçue dans une vision quasi paroptique, extra-rétinienne (2) et pour autant réellement sensible.
Le chemin est tracé et nous guide vers les limites extrêmes d’un corps regardant – qu’il soit individuel ou collectif – là où se situe aussi l’approche de Julie Chaffort avec (Y)our Song. De l’automne au printemps, s’offrent à elle les conditions d’une exploration longue (résidence territoriale de 6 mois) pour investir les formes d’expression sensible et secrète au langage à travers le corps, la danse, la musique et le chant en mettant en scène des personnes en situation de handicap et plus particulièrement de types sensoriels (trouble de la vue, de l’audition et de la parole). L’intelligibilité s’y fait nécessairement différente, dans un autre rapport au monde, par des savoirs étrangers, des états émotionnels dont il n’est pas donné à tous de faire l’expérience. L’acceptation de l’altérité de ces visibilités dissemblables les mutent en présences ressenties travaillant un regard commun alors augmenté car nourris de figures environnantes certes au contour brouillé, mais soufflant une réalité autre.
Le souffle est fruit d’une vie sous-jacente dont l’émanation se répand de maisons en maisons, donnant à l’ensemble de possibles airs de famille en les mettant en regard les unes les autres. À l’approche de l’été, Vincent Barré nous ouvre ses carnets de dessins dans A Family of Rooms. S’en échappent les souffles de toute une vie, perçus sur 50 voire 60 ans d’un parcours assidu, entamé dans la solitude des voyages et auprès de grandes figures rencontrées, en France et aux États-Unis, ou encore dans la suite des espaces parcourus et silencieux des grands musées. C’est là qu’a véritablement mûri celui qu’il est devenu. S’y ajoutent des fils de la vie qui le relient à d’autres artistes de la génération aînée, de grandes amitiés, et enfin ces artistes croisés dans l’enseignement, des artistes en devenir qu’il accompagnera. Au-delà d’une histoire trop « parée », trop écrite, d’une prétention déplacée à faire histoire de l’art, c’est d’abord une voix qui parle, une langue « parlée » dans le souffle d’une forme vivante de récit que se constitue dans l’apparentement de ses œuvres mises sous le regard d’œuvres choisies dans de grandes collections publiques et privées. Dans un tutoiement nourri d’amitié et de bienveillance, les œuvres modernes et contemporaines qui ont façonné sa personnalité peuvent être là physiquement, dans l’espace de l’exposition, pour poursuivre un dialogue jamais interrompu. Pour prolonger un souffle maintenu.